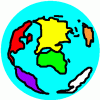Beiträge: 174
Sprache: Français
Altebrilas (Profil anzeigen) 1. Juni 2011 13:25:27
Sur la pratique même du bilinguisme, les représentations peuvent être négatives : « Ca fait trop, deux langues à la fois dans la tête d’une personne. Il faut apprendre une langue à la fois »Quand cessera-t-on de se représenter le cerveau comme un récipient rigide?
« Un professeur nous a dit que nous utilisions environs 6 000 mots. Quand on est bilingue on le divise par 2 ? et quand on est trilingue, par trois ? », s’inquiète F., en 2nde.

morico (Profil anzeigen) 9. Juni 2011 09:58:16
L'article infra de Claude Piron permet de combattre ce préjugé.
http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/cult...
morico (Profil anzeigen) 9. Juni 2011 10:30:22
«Si ces gens ne savent pas s'expliquer, c'est de leur faute».
Que les autorités politiques, les instances internationales, les forgeurs d'opinion puissent avoir une quelconque responsabilité dans les handicaps linguistiques, personne ne semble le soupçonner. D'ailleurs, ce handicap n'est jamais nommé, la notion n'existe pas; la chose n'est donc pas perçue.
L'article de Claude Piron
"Et si on prenait les handicaps linguistiques au sérieux?"
permet d'étudier la question sérieusement.
http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/ling...
Voici le sommaire
La situation: plus attristante qu'on ne le dit
Divers seuils de capacité linguistique
L'effet des sous-programmes inhibiteurs
Une solution à portée de la main
Multiplication contre addition
Pourquoi ne pas reprendre une ancienne proposition, parfaitement raisonnable?
morico (Profil anzeigen) 9. Juni 2011 10:44:52
L'article de Claude Piron ci-dessous permet de combattre ce préjugé.
Asie: anglais ou esperanto? Quelques témoignages.
http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/easi...
Extraits:
L'anglais, nous dit-on, est aujourd'hui la langue mondiale. C'est celle que l'on parle partout sur notre planète, y compris en Asie.
Si, dans une discussion sur ce sujet, un participant émet l'idée que l'anglais est trop difficile pour la grande majorité des Asiatiques et que les contraindre à l'utiliser revient à les inférioriser, il se fait immédiatement rabrouer. Plus encore s'il dit que l'espéranto offre une solution nettement plus acceptable. L'espéranto, lui réplique-t-on, est aussi difficile que l'anglais pour les non-Européens.
morico (Profil anzeigen) 9. Juni 2011 12:38:38
Affirmer cela, c'est montrer qu'on n'est pas conscient de ce qui fait la facilité ou la difficulté d'une langue. En Suisse, les élèves de langue italienne écrivent correctement à la fin de la première année primaire, alors que les jeunes francophones n'écrivent pas encore correctement à l'âge de 12-13 ans. Pourquoi ? Parce que l'orthographe de l'italien est simple, cohérente, alors que celle du français contient un nombre impressionnant de formes arbitraires qu'il faut mémoriser avec le mot, sans qu'on puisse se fier à la manière dont il se prononce. Moins il y a de détails à mémoriser, plus on progresse vite.
L'espéranto s'apprend plus vite que n'importe quelle langue européenne, quelle que soit la langue maternelle, tout simplement parce qu'il est plus cohérent.
On trouvera sous le titre «Asie : anglais ou espéranto - Quelques témoignages» (http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/easi...) un certain nombre de témoignages d'Asiatiques ayant appris et l'anglais et l'espéranto et qui comparent les deux langues du point de vue de la facilité. Seule une personne qui n'a rien vérifié peut affirmer que les deux langues présentent une difficulté égale.
Certes, l'espéranto est peut-être trois ou quatre fois plus difficile pour un Chinois que pour un Français. Mais cela n'enlève rien au fait qu'il est pour lui trente fois plus facile que l'anglais, langue au vocabulaire énorme dont la grammaire, l'orthographe et le lexique sont truffés d'incohérences.
extrait article Claude Piron
"Linguistes: ignorance ignorée"
http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/ling...
morico (Profil anzeigen) 9. Juni 2011 12:51:48
Extrait de Claude Piron, linguistes, ignorance ignorée.
Ce que la solution «anglais» peut avoir d'injuste et d'aberrant pour les 95% de la population mondiale dont ce n'est pas la langue maternelle n'est jamais envisagé.
Injuste.
L'anglais est une langue très difficile. Au début, elle paraît simple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de formes grammaticales à mémoriser. Mais plus on progresse, plus on se rend compte que cette facilité initiale est fallacieuse, jusqu'à ce qu'on finisse par prendre conscience de l'impossibilité d'arriver à une maîtrise parfaite de la langue, qui permettrait de se sentir sur un pied d'égalité avec les personnes de langue anglaise. «So much that is being said is correct, so little is right» («Ils forment tant de phrases correctes, mais si peu qui sonnent juste»), dit l'écrivain George Steiner au sujet d'étudiants étrangers censés avoir atteint en anglais un niveau opérationnel. En fait, une maîtrise comparable à celle d'un anglophone de naissance ne peut être atteinte que si l'on vit assez longuement dans un environnement où tout le monde parle anglais.
Les personnes de langue germanique atteignent souvent une meilleure maîtrise que les autres, parce que l'anglais appartient à la même famille que leur langue maternelle, mais la différence par rapport aux «natifs» n'en est pas moins considérable même chez elles.
Du fait de cette difficulté, toute relation entre un anglophone et un locuteur d'une autre langue est faussée : l'un est supérieur, l'autre est inférieur, le premier a une maîtrise absolue de l'outil linguistique, le second est moins bien armé pour défendre son point de vue.
L'injustice se situe également à un autre niveau, celui du temps que les non-anglophones doivent consacrer à l'étude de la langue, alors que cette perte de temps et cet effort considérable - il faut en moyenne entre 4000 et 8000 heures d'étude pour arriver à un bon niveau opérationnel - sont totalement épargnés aux personnes de langue anglaise, qui ont acquis la langue sans rien faire d'autre que de vivre avec leur famille et de fréquenter l'école de leur région.
La remarque suivante, réponse d'un scientifique coréen, Kim Hiongun, à une enquête de la BBC, souligne bien l'importance de cet effort : «La Corée investit des montants énormes dans l'enseignement de l'anglais. Si j'avais pu disposer de mon temps à ma guise, j'aurais pu obtenir cinq doctorats avec les années que j'ai dû consacrer à l'étude de cette langue». Les Britanniques, Américains et autres Australiens peuvent investir ce temps et cette énergie dans leur perfectionnement professionnel ou dans des loisirs, le reste du monde est privé de cette possibilité. Est-ce équitable ?
morico (Profil anzeigen) 9. Juni 2011 13:11:06
http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/ling...
extrait de "Linguistes: ignorance ignorée"
L'énorme difficulté de l'anglais tient à une foule d'incohérences qui n'apportent rien à la communication.
Dans la majorité des langues qui s'écrivent avec un alphabet, il suffit de connaître quelques règles d'orthographe pour pouvoir écrire correctement un mot que l'on sait prononcer. En anglais, l'orthographe n'a rien de facile, et il faut apprendre la prononciation, notamment la place de l'accent, avec chaque mot. Le a ne se prononce pas de la même manière dans nation et national, ni le i dans wild et wilderness, alors que dans les deux cas le second dérive du premier... Si la plupart des Occidentaux non anglophones prononcent mal sweatshirt et Reagan, c'est parce que rien ne permet de deviner comment les lettres ea vont se prononcer. La mise en mémoire de la prononciation et de l'orthographe de chaque nouveau mot appris représente pour tout élève d'anglais une somme d'énergie considérable. Le mot «aberrant» est justifié pour qualifier ce décalage entre écriture et prononciation, puisqu'il est absent de la plupart des langues et que cela n'affecte absolument pas la communication.
À une époque où l'on tente de convaincre les populations des avantages de la rationalisation dans les entreprises, il est vraiment étrange de choisir pour communiquer, parmi toutes les langues disponibles, une langue où le rapport efficacité/coût est aussi défavorable.
Cette aberration-là n'en est qu'une parmi des dizaines de milliers. La règle veut qu'on forme le pluriel d'un nom en lui ajoutant un s. Mais le mot woman `femme', fait au pluriel, à l'écrit women (on a remplacé le a par e), et à l'oral /wim'n/ (on a remplacé le son `ou', écrit o, par le son `i', lui aussi écrit o). Ou considérons la négation. Dans la quasi-totalité des langues du monde la négation suit un modèle régulier, valable pour tous les verbes. En français, si on sait dire je ne sais pas, on peut appliquer la même structure aux autres verbes et dire je n'ai pas, je ne peux pas, je ne suis pas. En anglais, le modèle de I do not know `je ne sais pas' n'est pas applicable à un certain nombre d'autres verbes. On doit dire I am not `je ne suis pas', non I do not be. En plus, l'orthographe est aberrante ici aussi. `Je ne dois pas' s'écrit en trois mots : I must not, mais `je ne peux pas' en deux : I cannot. Quant à la négation des adjectifs et des substantifs, elle se fait dans la plupart des langues par un préfixe qui reste toujours lui-même. En anglais, c'est tantôt in- (injustice, invisible), tantôt un- (unjust, unpleasant)[...]
Il ne semble pas venir à l'esprit de nos linguistes qu'une langue bourrée d'incohérences, comme l'anglais, sera automatiquement moins performante qu'une langue essentiellement régulière, comme l'esperanto.
morico (Profil anzeigen) 9. Juni 2011 13:27:42
Extrait de Linguistes: ignorance ignorée
http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/ling...
- «La véritable raison pour laquelle l'espéranto ne s'est pas propagé plus qu'il ne l'a fait est qu'il est artificiel»,
- «Comme il n'était associé à aucun courant politique important, il n'a pas été très loin»,
Ces phrases considèrent l'espéranto comme un fait relevant de l'histoire passée, ou comme condamné à un échec dans l'avenir, et non comme une réalité actuelle en plein développement. Certes, nul ne peut dire si l'espéranto existera encore dans cinquante ans, mais on n'a pas davantage le droit d'affirmer, avec une parfaite assurance, qu'il a échoué, qu'il a eu sa chance et n'a pas su la saisir, ou qu'il est arrivé à son niveau de développement maximal. L'hypothèse selon laquelle la propagation de l'espéranto suit le rythme lent des phénomènes historiques d'ordre culturel et politico-social est au moins aussi probable que les affirmations reproduites ci-dessus, qui ne sont, elles aussi, que des hypothèses.
Or, si on le compare au remplacement des chiffres romains par les chiffres arabes, ou, dans d'autres domaines, à l'abolition de l'esclavage et à la promotion de la femme dans la vie politique et économique, on se rend compte que le rythme de l'histoire est très lent dès lors qu'il s'agit de changer les mentalités pour adopter une innovation qui finira par être pour tous un progrès. Les innovations qui vont dans le sens d'une plus grande justice suscitent toujours une résistance. Elles vont à l'encontre de l'intérêt de groupes puissants qui font tout pour garder leurs privilèges. L'humanité résiste aussi, probablement par peur de devoir s'adapter, donc de devoir changer des habitudes fortement ancrées, aux innovations non techniques, non matérielles, qui sont simples, pratiques, facilitent la vie quotidienne et sont le fruit de la créativité humaine. D'où la lenteur de leur diffusion.
Le système métrique en est un exemple typique. Il a été proposé par Gilbert Mouton en 1647. Cent vingt ans après sa publication, en 1767, il n'était utilisé nulle part et n'était connu que de quelques farfelus. Par comparaison, le succès de l'espéranto est tout à fait remarquable puisque aujourd'hui , environ 120 ans après son apparition sur la scène mondiale, on trouve des gens qui le pratiquent dans de très nombreuses villes de plus de cent pays, et dans bon nombre de localités moins importantes. Dans ces conditions, la question se pose de savoir si nous n'en sommes pas au stade où la courbe exponentielle est encore plate. Répondre par la négative, comme le font nos linguistes, n'est pas scientifique. Répondre par l'affirmative ne le serait pas non plus. L'histoire nous apprend qu'il est trop tôt pour trancher
morico (Profil anzeigen) 9. Juni 2011 13:46:42
Ce préjugé est critiqué par Claude Piron
L'esperanto, le meilleur tremplin pour les langues
http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/trem...
Extraits
Cela dit, revenons à la fonction propédeutique de l'espéranto. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Qu'une année scolaire d'espéranto avant l'étude d'une autre langue fait gagner au moins une année à celle-ci. L'expérience a été faite suffisamment, en Grande Bretagne, en Finlande, en Allemagne et dans d'autres pays pour qu'il n'y ait aucun doute. Les élèves qui font un an d'espéranto et cinq ans d'anglais sont aussi bons ou meilleurs en anglais que ceux qui ont fait six ans d'anglais. Je dis «anglais», mais j'aurais pu mettre «allemand», «latin» ou «russe». Le rapport du groupe de travail créé par le Ministère finlandais de l'éducation nationale pour étudier la valeur pédagogique de l'espéranto le confirme clairement:
«Les résultats d'expériences pédagogiques montrent, entre autres choses, qu'un cours d'espéranto organisé dans une optique propédeutique améliore considérablement le succès des élèves dans l'étude des langues étrangères».
Je suis personnellement un exemple vivant de cette réalité. L'espéranto a été ma première langue étrangère. Il m'a donné le goût des langues, il a représenté pour moi une sorte de cours de linguistique générale concrète, il m'a déconditionné des habitudes arbitraires de ma langue maternelle sans que je doive me reconditionner d'emblée selon les habitudes arbitraires d'un peuple étranger, bref, il m'a donné une avance sur mes camarades que je n'ai jamais perdue.
L'espéranto motive pour apprendre les langues étrangères parce qu'il met en contact avec le monde extérieur.[...]
morico (Profil anzeigen) 9. Juni 2011 14:05:27
Claude Piron démonte également ce préjugé.
http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/lang...
"Langue occidentale, l'espéranto?"
Extraits:
Si l’on considère l’espéranto de l’extérieur, on est tenté de le prendre pour une langue occidentale. Ses sonorités rappellent celles de l’italien et le vocabulaire a l’air d’être en grande partie d’origine latine. En outre, ceux qui ont l’occasion d’entendre une conversation dans cette langue ne tardent pas à remarquer que "oui" se prononce yes, comme en anglais (on écrit jes). Ce fait semble en confirmer le caractère occidental. L’auditeur plus attentif qui perçoit la présence de nombreuses racines germaniques reste sur la même impression: tout évoque une langue occidentale apparemment dotée d’un lexique où, comme en anglais, se côtoient apports latins et germaniques[...]
La plupart des Occidentaux ne se doutent pas qu’il existe des langues si cohérentes que la notion même de verbe irrégulier, de pluriel exceptionnel, de dérivation aberrante y est tout simplement impensable. Parmi ces langues on compte le chinois, le vietnamien… et l’espéranto. Ces trois langues ont ceci de commun, et de différent de toutes les langues indo-européennes, qu’elles sont composées d’éléments rigoureusement invariables qui se combinent entre eux à l’infini[...]
Une même similitude de structure se retrouve entre chinois et espéranto dans la formation des mots[...]
Les personnes qui reprochent à l’espéranto d’être trop occidental négligent deux aspects importants de la question. D’une part, ils jugent de façon purement superficielle, sans entrer dans l’analyse linguistique de la langue, qui seule peut révéler à quel point elle est, en profondeur, différente de ce qu’elle semble être à première vue. D’autre part, ils oublient qu’une langue de communication internationale est de toute façon nécessaire. Sur quelle langue se rabat-on, en pratique, quand on n’a pas de langue commune? Sur l’anglais ! Or, celui-ci est une langue beaucoup plus occidentale que l’espéranto et beaucoup plus difficile à acquérir et à manier pour la grande majorité des habitants de notre planète. Aucune langue ne pourrait mettre tous les peuples à égalité. Mais de toutes celles qui existent et qui sont utilisées en pratique, l’espéranto est celle qui s’approche le plus de cet idéal.
Au bout de 2000 heures d’anglais (5 heures par semaine pendant 10 ans), le Japonais et le Chinois moyens sont incapables de s’exprimer de façon réellement opérationnelle dans la langue du Wall Street Journal, ils n’en sont qu’au stade du balbutiement. Après 220 heures d’espéranto, en moyenne, ils peuvent réellement communiquer avec aisance. Cette différence n’a rien d’étonnant pour qui étudie les structures linguistiques des diverses langues.