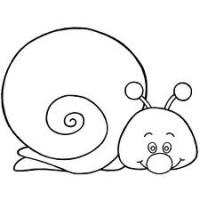La langue anglaise, construit-elle une manière de penser différente de la langue française ?
de Francestral, 17 de junho de 2013
Mensagens: 32
Idioma: Français
Francestral (Mostrar o perfil) 18 de junho de 2013 22:08:12
robbkvasnak:J’étais élevé bilingue : allemand et anglais (américain). Souvent je me suis demandé pourquoi je semble avoir une personnalité différente en allemand et en anglais.Quelles étaient ces différences de personnalité ? Quelles en étaient les causes ?
Altebrilas:Suivant les langues, on se posera des questions que l'on peut éviter de se poser dans d'autres, comme:Bien vu.
- la relation précise entre un objet et celui qui le détermine
- l'action effectuée pour obtenir un résultat
- le rapport hiérarchique entre les interlocuteurs
- le fait qu'une action soit répétée ou habituelle, ou non
- etc.
et à chaque fois que nous hésitons entre deux mots à employer, parce qu'il n'y en a qu'un dans notre langue, ce mécanisme se met en oeuvre pour influencer notre pensée.
En français, je me demande si je dois garder ma distance ou non avec une personne (tutoiement ou vouvoiement ?).
En anglais, je me demande si une action passée est finie ou pas encore (preterit ou present perfect ?).
Y a-t-il d'autres exemples de ce type ? Quelles questions se pose-t-on plus souvent en français qu'en anglais ? Quelles questions se pose-t-on plus souvent en anglais qu'en français ?
robbkvasnak (Mostrar o perfil) 19 de junho de 2013 19:29:44
Francestral:Si tu n'es pas vraiement bilingue tu ne comprendras pas ce que je veux dire. Mais je ne suis pas le seul á expériencer ce phenomènerobbkvasnak:J’étais élevé bilingue : allemand et anglais (américain). Souvent je me suis demandé pourquoi je semble avoir une personnalité différente en allemand et en anglais.Quelles étaient ces différences de personnalité ? Quelles en étaient les causes ?
Altebrilas (Mostrar o perfil) 19 de junho de 2013 23:37:14
robbkvasnak:Je veux bien croire qu'un monolingue de naissance ne peut pas ressentir cela. Il faudrait demander aux denaskuloj s'ils ressentent la même chose.
Si tu n'es pas vraiement bilingue tu ne comprendras pas ce que je veux dire. Mais je ne suis pas le seul á expériencer ce phenomène
Par contre, vous pouvez nous dire si ce que vous ressentez en passant de l'anglais à l'allemand est analogue à ce qu'on peut ressentir en passant d'un milieu où l'on s'exprime de façon familière à un milieu où l'on s'exprime de façon soutenue, par exemple un adolescent n'a souvent pas la même personnalité en présence de ses parents ou de ses amis, et sont souvent gênés lorsqu'il est en présence des deux milieux en même temps. Ou lorsque vous voyagez dans un pays anglophone parlant un autre dialecte et possédant une autre culture..
Bref, est-ce principalement une question de langue, d'auditoire ou de culture?
yyaann (Mostrar o perfil) 20 de junho de 2013 01:02:49
Il se trouvait idiot de n'avoir rien vu venir et maudissait ce charlatan. Dans le ciel, un coup de tonnerre retentit. -> He felt like a fool for not having seen it coming and loathed that imposter. Up in the sky, the thunder cracked.
L'anglais, peut-être poussé à cela par la concision de ses "nouns modifiers", aura aussi tendance à charger plus sa phrase en détails que le français.
Le plaisir de vacances au soleil sur le sable chaud. -> The utter enjoyment of sun-filled holidays on a warm-sand beach.
Quoi de plus évident pour un français que le sentiment de "dépaysement"? Pour ma part ce mot me semblait si naturel que j'ai eu du mal à croire que l'anglais n'en avait pas l'équivalent. Bien sûr, je peux décrire en anglais à quoi renvoit ce concept. Mais si chaque fois que je veux y faire référence je dois passer par plusieurs phrases (qui seront différentes en fonctions du contexte car le dépaysement peut être de différentes natures), vais-je être aussi prompt à en parler qu'en français? Dans mon cas, la réponse est clairement non. On pourrait même pousser la réflexion plus loin : si le fait d'avoir un nom pour ce concept me rend plus prompt à en parler, ne deviens-je pas aussi plus prompt à y penser et à voir certains faits à travers le prisme de ce concept?
Si on se penche maintenant sur l'aspect culturel du langage, en anglais britannique, le penchant pour les euphémismes est de loin supérieur au français.
La chaleur est épouvantable dans ce pays ! -> This country is a bit too hot for my taste.
Il a pour réputation d'aimer des plats particulièrement écœurants -> He's been known for his rather controversial idea of a good meal.
Il n'a pas cessé de mentir tout au long de l'entretien -> He had a rather economical approach to the truth troughout the interview.
Les deux langues possèdent des mots qui renvoient directement aux réalités sociales et culturelles des pays où elles sont parlées. L'anglais n'a pas d'équivalent pour "terroir" ou pour "climat social". De même si l'on pourrait peut-être traduire "Come off it!" par "Arrête un peu ton cinéma", on y retrouve pas l'appel à retrouver une modération toute britannique que sous entend la phrase originale lorsqu'elle s'adresse à un anglais qui a commis "l'erreur" d'adopter un ton un peu solennel ou premier degré.
Tous ces petits détails et bien d'autres créent, sinon une manière différente de voir le monde, au moins une ambiance sensiblement différente quand on passe d'une langue à l'autre. Peut-être cela explique-t-il pourquoi certains vont jusqu'à en sentir leur personnalité cha...
Leonez (Mostrar o perfil) 20 de junho de 2013 11:02:24
Altebrilas (Mostrar o perfil) 21 de junho de 2013 12:09:16
yyaann:Il y a là, à mon avis, un problème de méthode: comment peut on comparer deux phrases qu'on a déclarées (soi-même?) équivalentes, pour en extraire la différence et en tirer des conclusions?
Si on se penche maintenant sur l'aspect culturel du langage, en anglais britannique, le penchant pour les euphémismes est de loin supérieur au français.
La chaleur est épouvantable dans ce pays ! -> This country is a bit too hot for my taste.
Il a pour réputation d'aimer des plats particulièrement écœurants -> He's been known for his rather controversial idea of a good meal.
Il n'a pas cessé de mentir tout au long de l'entretien -> He had a rather economical approach to the truth troughout the interview.
Il faudrait savoir qui a fait cette traduction (symbolisée, je suppose par la flèche "->" ), quel était le parti-pris du traducteur, c'est à dire qu'a-t-il décider de conserver ou de sacrifier...
S'agit-il d'une analyse statistique de répliques tirées de romans, de films, ou autres; ces médias sont ils représentatifs de la sociologie des locuteurs? etc. Bref, le problème semble un peu plus complexe qu'au premier abord.
Quelle conclusion pourrait on tirer de la traduction inverse ?
This country is a bit too hot for my taste
-> Ce pays est un peu trop chaud pour mon goût
He's been known for his rather controversial idea of a good meal
-> Il est connu pour sa conception un peu spéciale d'un "bon repas".
He had a rather economical approach to the truth troughout the interview.
-> Il a pris des libertés avec la vérité tout au long de l'interview.
skargo (Mostrar o perfil) 22 de junho de 2013 05:56:34
La culture serait le territoire, la langue en serait une carte, non pas la carte mais bien une carte. En ce sens, même si le territoire peut avoir une influence sur la carte que l'on dessine, c'est surtout la richesse de la carte que l'on dessine qui a son importance.
Fiction : le Français laisse place à l'anglais, il peut alors y avoir deux options. Soit la culture Française enrichie la langue anglaise et force celle-ci à s'étendre conceptuellement aux deux cultures en en créant finalement une troisième mixte (les langues n'ont jamais été figées), soit la culture Française se fait absorber par la culture anglaise, en ce cas je pense que le rôle de la langue n'aura été que secondaire.
Inversement, les anglais se mettraient à parler français, ça ne les empêcheraient peut-être pas forcément de continuer à psalmodier "Que Dieu protège la Reine".

Ceci dit, je reste bien accroché, bec et ongles, à ma langue.
skargo (Mostrar o perfil) 22 de junho de 2013 06:20:35
yyaann (Mostrar o perfil) 22 de junho de 2013 10:24:54
Altebrilas:Oui, bon, je cherchais pas à être scientifique non plus hein.
Il y a là, à mon avis, un problème de méthode: comment peut on comparer deux phrases qu'on a déclarées (soi-même?) équivalentes, pour en extraire la différence et en tirer des conclusions?
 C'était juste pour illustrer à gros trait cette tendance de l'anglais britannique à utiliser les understatements à tout bout de champs que je crois avoir repérée.
C'était juste pour illustrer à gros trait cette tendance de l'anglais britannique à utiliser les understatements à tout bout de champs que je crois avoir repérée.Maintenant, une petite recherche montre que mon impression n'est pas dénuée de fondement. Quelques liens :
Dans cette étude statistique comparative d'un corpus oral d'anglais américain et britannique il semble se dégager que les anglais font moins référence à leurs affects et utilisent moins de quantificateurs emphatique (les américains utilisent beaucoup too, so, real, exactly).
Un expatrié américain qui travaille depuis 30 ans avec des britanniques juge dans cet interview que, dans la culture britannique, « l'expression directe d'émotions est refoulée ; la gêne et l'agressivité ne sont exprimées que par l'humour et les litotes ».
Dans cette analyse linguistico-culturelle (p 39-43), l'auteur juge que le soucis anglophone et notamment britannique de ne jamais exagérer se traduit en pratique par une préférence pour les understatements.
Dans cette leçon d'anglais élaborée par un britannique, il est recommandé aux élèves allemands d'utiliser plus d'understatements quand ils parlent anglais (p 2).
Enfin, dans ce dernier document (p 41), la reproduction d'un article de The Economist nous donne quelques exemples concrets de litotes et de phrases ironiques typiquement anglaises.
Up to a point (Dans une certain mesure) => No, not in the slightest (Non, pas le moins du monde).
I hear what you say (J'entends ce que vous dites) => I disagree and I do not want to discuss it any further. (Je ne suis pas d'accord et je ne souhaite pas en discuter davantage)
By the way/Incindentally (Au fait/Entre parenthèse) => The primary purpose of our discussion is... (L'objet principal de notre débat, c'est...)
A mon avis, seul le dernier exemple marche aussi en français (davantage avec entre parenthèse qu'avec au fait toutefois), mais il s'agit plus d'ironie que de litote.
Smarties (Mostrar o perfil) 14 de julho de 2013 13:05:37
kefga_x:Vu qu'à priori ça n'a pas été relevé je déterre un peu le message.HaleBopp:Les anglais n'ont pas de vouvoiement de politesse et ne respectent pas la priorité à droite. Quel peuple barbare !Mais même là on voit qu'au Québec, on passe au tutoiement beaucoup plus vite qu'en France. Est-ce que ces francophones sont donc des barbares aussi ?Par ailleurs, on peut tutoyer nos profs au Québec, quelque chose d'impossible en France je crois.
Le tutoiement existe aussi en anglais, au moyen du pronom thou : cependant les seules fois où je rencontre ce mot c'est pour parodier les parlers nobles.
Ensuite pour le vouvoiement, il dérive du pluriel de majesté.
Pour reprendre cet exemple, quand on utilise "tu" on s'adresse à l'homme, quand on utilise "vous" on s'adresse au professeur qui représente la classe entière (lui + classe > pluriel).
Bonne journée.